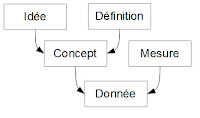Les mathématiques explorent divers « petits mondes » : l'espace euclidien, les espaces de Riemann, les nombres entiers, les probabilités, etc. Des passerelles existent et certains d'entre eux peuvent s'agréger en un plus grand « petit monde », mais chacun répond à une intuition particulière et son exploration requiert une démarche qui lui est propre.
Le calcul des probabilités développe ainsi une tournure d'esprit qui ouvre à la pensée une avenue inédite : l'intuition probabiliste, n'étant pas innée, est absente chez nombre de personnes.
* *
Deux attitudes s'opposent de façon polaire dans la relation que l'on peut avoir avec les maths : l'une, formaliste, convient aux personnes qui ont l'esprit clair et une bonne mémoire. J'ai eu ainsi à l'Ecole polytechnique des camarades auxquels les maths ne présentaient aucune difficulté : pour pouvoir assimiler un de leurs « petits mondes », il leur suffisait de vérifier la cohérence des hypothèses et l'exactitude du raisonnement.
D'autres ont avec les maths un rapport plus difficile car ils se posent deux questions auxquelles le cours ne répond pratiquement jamais : « pourquoi » et « comment ». Pourquoi a-t-on choisi telles hypothèses ? Comment s'y est-on pris pour bâtir les inférences et les démonstrations ?
Ces questions ne sont pas les bienvenues. Un de mes amis, rencontrant au lycée des intégrales pour la première fois, demanda au professeur à quoi elles pouvaient servir. Il pensait à leur apport au développement logique des maths mais le professeur crut qu'il voulait savoir si elles pourraient l'aider à « gagner sa vie » : il se fit réprimander.
* *
Le formaliste, qui ne cherche pas « midi à quatorze heures », n'est jamais tracassé par une inquiétude. Tout est évident devant son regard limpide et si l'assimilation du cours lui demande un travail celui-ci, réduit à une vérification technique, n'implique ni passion, ni souci, ni interrogation. Il est un bon élève tandis que celui que tracassent le « pourquoi » et le « comment » s'embarrasse de préoccupations qui sont inutiles lorsque le but est d'« avoir de bonnes notes », d'« avoir son bac », de « réussir aux concours », etc.
Quelle est donc, se demande en effet ce dernier, l'intention qui a conduit Galois à considérer les groupes de commutations ? Quelles sont celles qui ont poussé Newton vers le calcul différentiel, incité Gauss à explorer les congruences, Lagrange à chercher les équations de la mécanique, Cantor à considérer des ensembles infinis ? Comment chacun s'y est-il pris ensuite pour explorer le « petit monde » qui s'ouvrait devant lui ?
Il se peut que ce mauvais élève à l'esprit récalcitrant soit mieux préparé que ne l'est le formaliste au jour où il faudra dépasser l'apprentissage pour aborder la recherche, car comme il s'est familiarisé avec ce qui se passe dans la tête d'un chercheur il s'est rapproché de l'esprit de la recherche.